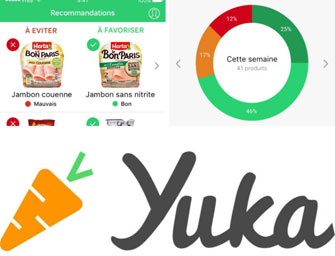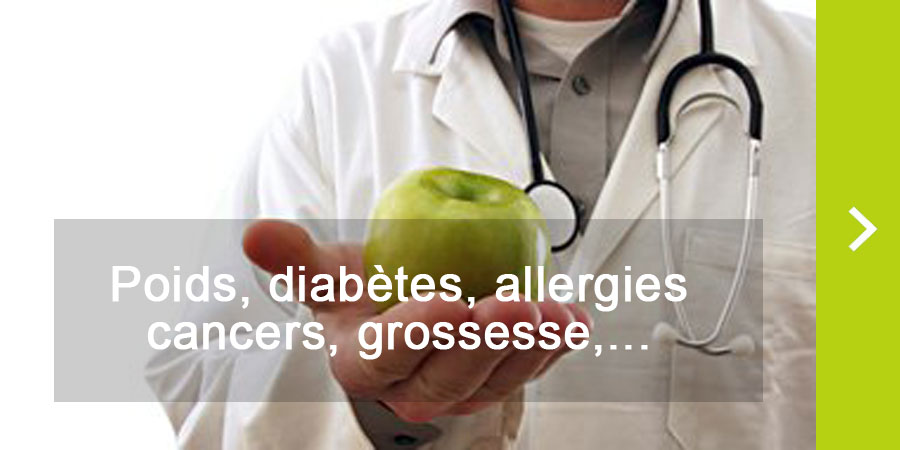L’alimentation et l’activitéphysique participent aux inégalités sociales de santé, inégalités en ligne de mire du Programme national nutrition santé (PNNS).
C’est dans ce cadre que la Direction générale de la santé (DGS) a sollicité l’Inserm afin d’établir un bilan des connaissances sur les déterminants de ces inégalités liées à la nutrition et sur les stratégies d’interventions susceptibles d’y remédier. Les inégalités de santé en lien avec l’alimentation et l’activité physique résultent d’un ensemble de processus, dans lequel interviennent des choix individuels influencés par divers facteurs (environnementaux, économiques, culturels, psychologiques…). Parmi ces déterminants, le rôle des agencements territoriaux en tant qu’espaces administrés, aménagés, appropriés et vécus par une société est complexe et pas moindre.
L’ancrage régional transcende les clivages sociaux
Malgré l’uniformisation redoutée de nos consommations alimentaires du fait de la «mondialisation», il existe une grande variété de régimes alimentaires au niveau international comme à l’échelle régionale. En France, les données de la cohorte E3N ont permis d’établir des tendances régionales dans les comportements alimentaires. À l’ouest, une place importante est donnée aux poissons, fruits de mer, pommes de terre et matière grasse animale; au nord, ce sont les apports en produits carnés et boissons sucrées qui sont plus élevés ; à l’est, les apports en fruits et légumes, produits laitiers et poissons sont faibles et, dans les régions du sud-ouest et du pourtour méditerranéen, ce sont les huiles végétales, fruits et légumes, pâtes, riz et oeufs qui sont le plus consommés. Ces traits régionaux confirmés par d’autres enquêtes(SU.VI.MAX, INCA 2) transcendent les clivages sociaux et ne sont pas spécifiques à la France. Ces différences régionales, voire internationales, témoigneraient de la diversité des modes de production, de distribution et d’approvisionnement des produits alimentaires, mais aussi des croyances et attitudes de la population vis-à-vis des produits et plus généralement des modes de vie. À noter que si, selon l’étude MONICA, dans le nord et l’est de la France la qualité nutritionnelle des apports est fonction du niveau d’éducation, elle ne l’est plus dans le sud-ouest caractérisé de façon indifférenciée par une meilleure qualité des apports alimentaires. Ainsi, les inégalités sociales face à l’alimentation se nichent au sein de systèmes alimentaires régionaux et locaux stables et lents à évoluer.
L’importance de la structuration sociale
À plus petite échelle ont été mis en évidence des liens souvent sous-estimés entre le niveau socioéconomique du quartier de résidence et les apports alimentaires, et ce indépendamment du statut social des résidents. Les populations des quartiers défavorisés consomment moins de fruits et légumes, de poisson ; achètent moins souvent des produits riches en fibres, pauvres en graisse, sel et sucre. Ces variations de consommations alimentaires entre quartiers de résidence ne résultent pas uniquement d’effets de compositions sociales de la population. Outre des facteurs liés aux infrastructures implantées, les modes d’organisation sociale, politique et culturelle du quartier y participent. En effet, l’influence de l’accessibilité à l’offre alimentaire ne se résume pas à une question de disponibilité ou de proximité de cette offre. Le rapport des habitants à leurs espaces de vie, les dynamiques sociales du quartier, les modalités d’accès sont à prendre en compte.
En conclusion
Les comportements alimentaires ne sont pas qu’une affaire individuelle mais relèvent d’une construction collective et partagée. Dans ce cadre, les interventions sur l’offre alimentaire consistent soit à promouvoir des aliments recommandés dans des structures existantes implantées dans les zones sous-équipées ; soit à introduire une nouvelle offre au sein des quartiers mal équipés : implantation des supermarchés, développement des marchés, de l’agriculture péri-urbaine ou de jardins communautaires.
Pour aller plus loin :
(1) Inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation et l’activité physique. Collection Expertise collective, Inserm, juin 2014.
-
Boissons énergisantes : face aux risques avérés, une réglementation s’impose
-
Boissons énergisantes: l'ANSES identifie les risques associés aux boissons énergisantes
-
L’ostéoporose, un mal qui frappe au cœur des os
-
Remplacer le soda par du lait, du café ou du thé diminuerait le risque d’accident vasculaire cérébral
-
Le fromage jouerait un rôle important dans le fameux french paradox
-
Avis scientifique sur l'apport maximal tolérable en vitamine D